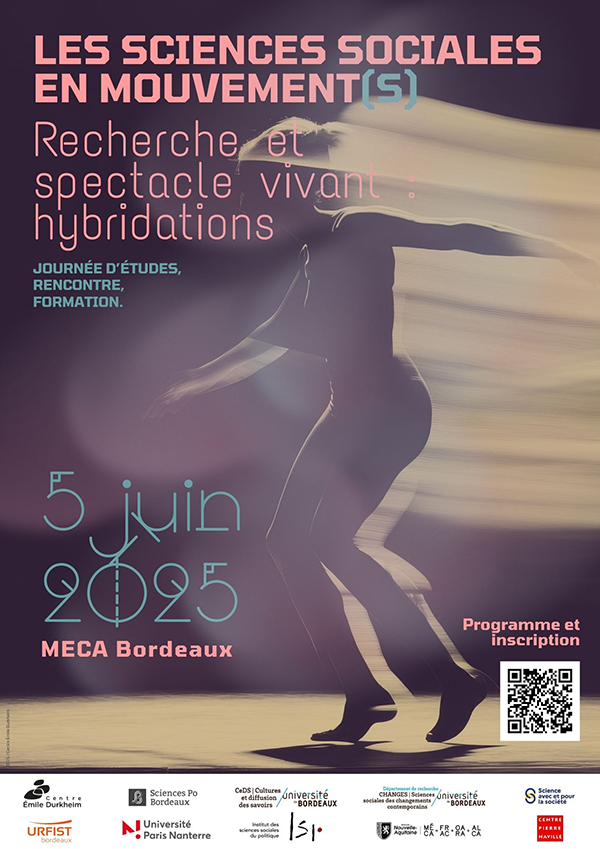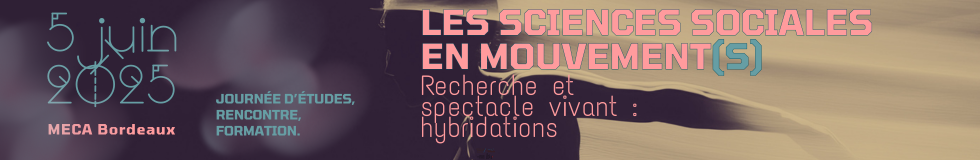
|
|
|
Navigation
SUPPORT
|
Argumentaire Les sciences sociales en mouvement(s). Recherche et spectacle vivant : hybridations
Le Centre Émile Durkheim, le laboratoire Culture et Diffusion des savoirs et l'URFIST de Bordeaux s’associent pour organiser le 5 juin 2025 à la MECA à Bordeaux une journée intitulée « Les sciences sociales en mouvement(s). Recherche et spectacle vivant : hybridations ». Cette journée d’études/rencontre/formation souhaite contribuer au développement du dialogue entre sciences sociales et approches artistiques. Par la réflexion partagée avec les intervenant·es artistes et chercheur·ses mais aussi par l’expérimentation en public, elle vise à former les acteur·ices des deux sphères à la collaboration dans des espaces de recherche-création et de communication scientifiques innovants. Par la mise en lien de différents laboratoires, elle est la préfiguration d’un réseau national de chercheur·ses en sciences sociales mobilisant les arts vivants. Comme support d’un objet documentaire sur les enjeux de la communication scientifique via des approches artistiques, elle veut rendre plus visible la plus-value de cette collaboration et permettre son essaimage. Le projet s’adresse à trois types de public : chercheur·ses et étudiant·es, acteur·ices des sphères culturelles et artistiques, et enfin public large chez qui nous souhaitons favoriser une analyse réflexive sur le monde social via l’expérience artistique. .......
Au cours de la journée elle-même, nous chercherons à explorer les questionnements suivants : 1. L’intégration du spectacle dans la recherche est-elle un moyen d’enquête ou un moyen de restituer l’enquête ? Qu’apporte à la recherche la collaboration avec les arts vivants par rapport à d’autres types d’arts : la photographie, le cinéma, la sculpture, des créations sonores… ? Réciproquement, qu’est-ce qui peut motiver l’intégration de la recherche dans le spectacle ? Que cherche/qu’attend un.e artiste qui va vers les sciences humaines et sociales pour créer un spectacle ? 2. Artistes et chercheur·es : on se connait ? Comment s’informe-t-on l’un.e sur l’autre, l’un.e et l’autre ? Dans quelles circonstances se noue la collaboration ? 3. Comment s’organise en pratique la collaboration ? Quelles sont les difficultés à lever, les points à expliciter pour travailler ensemble, les zones d’ombre de la collaboration, les freins, les méfiances, les peurs, les doutes ? Quelle acculturation minimale réciproque ? 4. La traduction/le passage du contenu scientifique à une création : Qui propose ? Comment ? Quels points de discussion/tensions ? Qui écrit : l’un·e d’abord, l’autre après, les deux puis on confronte, seulement l’artiste ? De la rencontre au spectacle, en passant par la conception, la coordination, le travail logistique, scientifique et artistique, quelles sont les temporalités de la collaboration ? Qui les détermine ? 5. Qu’est-ce qui est « produit » ? Qui joue ? Pour qui ? Qu’est-ce qui se joue ? 6. De l’intérieur, quelles leçons à tirer ? Que retient-on de sa participation, de son rôle à chacun·e et du travail commun ? Qu’est-ce que ça apporte aux arts vivants de travailler avec la recherche, et vice versa ? Quels points de vigilance ? Quels apprentissages ré(tro)spectifs ? 7. De l’extérieur, quels retours nous sont faits ? Nous étonnent-ils ? Qu’en retenir pour la suite ? le public atteint correspond-il au public visé ? 8. Art et sciences…. Art ou sciences ? La création est-elle un medium de diffusion d’un contenu scientifique perçu comme « premier » ? Le contenu scientifique est-il source d’inspiration pour un geste créatif « premier » ? Où se trouve le curseur ? Sa position est-elle explicitée en amont de la collaboration ? Qui/quoi décide de cette position ? |